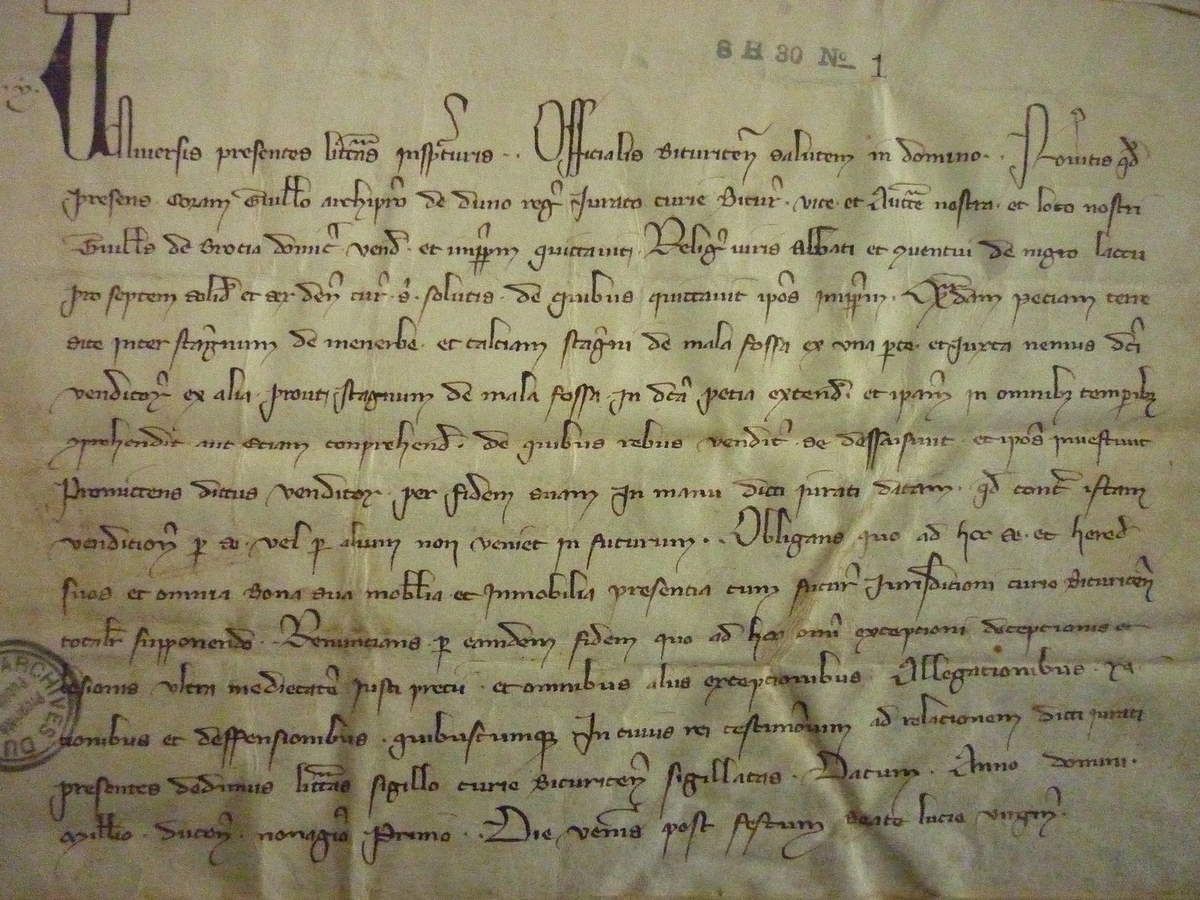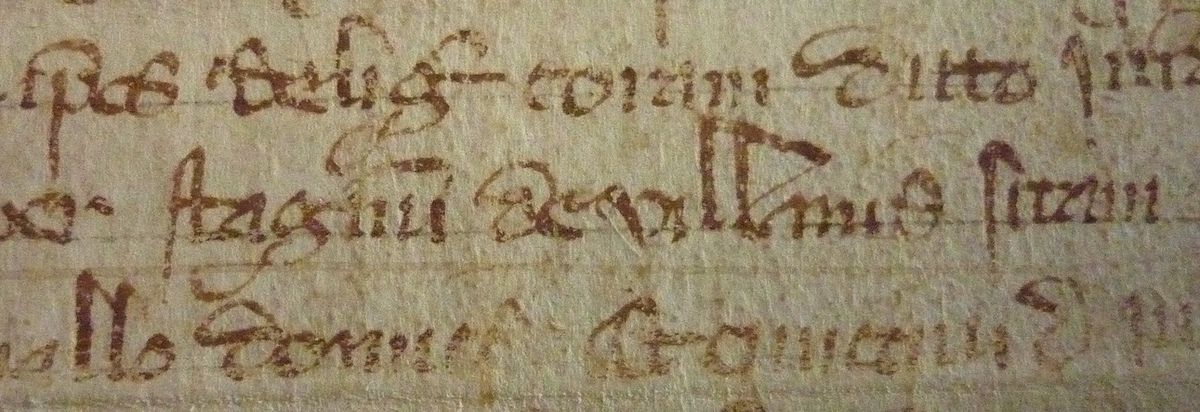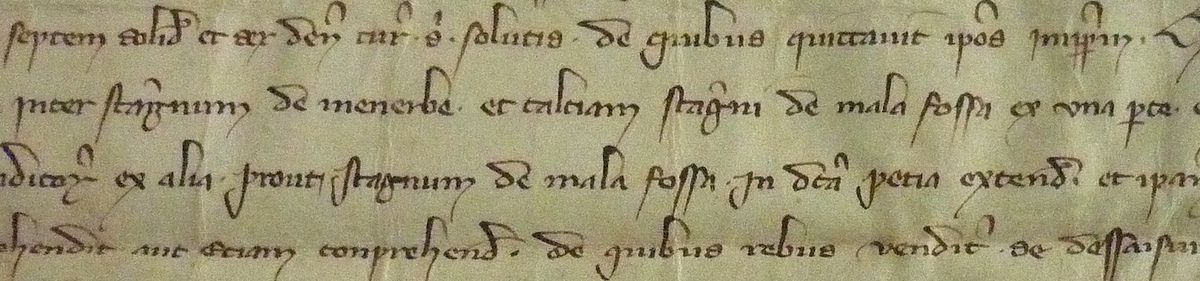/image%2F1492036%2F20230807%2Fob_1873f5_4.png)
église paroissiale et prieurale de Vernais (18)
Il vous sera peut-être arrivé, au cours de vos voyages, de visiter d'anciens prieurés médiévaux, très souvent présentés comme de micro-monastères, hébergeant une petite population de moines ou de moniales éloignés de leur abbaye d'origine.
Ce modèle, quoique séduisant en terme spirituel, s'applique, en fait à très peu d'endroits. Quelques exemples relevés en Berry du Sud permettent de mesurer de toute la complexité du phénomène.
Le point de départ de la méprise sur la nature réelle d'un prieuré est à rechercher dans le terme lui-même, qui évoque le mot prière. Il n'en fallait pas plus pour que certains concluent de manière hâtive que des religieux avaient séjourné dans presque tous les villages, éclairant les populations de leur savoir et de leur piété. Cette vision un peu naïve héritée de la période romantique mérite d'être corrigée à l'examen du contenu des chartes médiévales conservant le souvenir des multiples donations accordées au clergé par la société civile.
A l'origine de chaque prieuré se trouve un don de terres, de bâtiments, de rentes, à une abbaye. Certains dons, très modestes, ne rapportaient presque rien à leurs bénéficiaires. D'autres, plus conséquents, étaient situés si près des monastères qu'ils se fondaient naturellement dans l'ensemble de leur domaine foncier. Plus compliquée était la situation de donations éloignées du lieu de vie de leurs nouveaux propriétaires, dont la gestion nécessitait la présence de religieux envoyés sur place par leur abbé. La question est alors de savoir si cette présence était pérenne, ou simplement temporaire. La seule manière objective d'y répondre est d'évaluer l'importance du don (était-il suffisant pour assurer le quotidien d'une communauté religieuse?), la distance entre le lieu de ce don et l'abbaye (parfois des centaines de kilomètres) et bien entendu la règle observée dans le monastère d'origine: il n'est pas réaliste d'imaginer des moines ayant fait vœu de vie communautaire s'éloigner de leur cloître pour mener une existence quasi-solitaire dans de minuscules prieurés ruraux.
Quelques exemples berrichons illustrent la complexité de ce dossier et invitent à la plus grande prudence en matière de lecture du passé d'un lieu précis.
/image%2F1492036%2F20230807%2Fob_71170f_1.png)
Souvigny
Les grands prieurés urbains
Un exemple bien connu en Berry: Souvigny. Grâce à la générosité de la féodalité locale, Cluny peut implanter une communauté autonome à Souvigny, dotée d'une prieurale indépendante et de bâtiments conventuels. Un prieur fait office d'abbé, le couvent bat sa propre monnaie, la prieurale s'élève proche de l'église paroissiale.
/image%2F1492036%2F20230807%2Fob_24b5a1_5.png)
église paroissiale et prieurale d'Allichamps, proche de Bruère-Allichamps (18)
Les prieurés urbains et villageois
De loin les plus nombreux et surtout, les plus mal connus. Leur importance est proportionnelle à la richesse de la donation initiale, souvent difficile à évaluer sans une étude fine des chartriers abbatiaux sur plusieurs siècles. A de très rares exceptions près, les bâtiments agricoles ont disparu ou ont changé d'affectation. Ainsi, la grange de l'ancien prieuré bénédictin de Drevant, dans le Cher, est devenue, à une époque qu'il conviendrait de déterminer, une église, remplaçant la minuscule église romane partagée par les moines du Moutier-d'Ahun, lors de leurs séjours sur place et par le curé de la paroisse. Parfois, le prieuré accueille une communauté permanente aussi influente que les abbayes locales: l'exemple de La Chapelaude, dans l'Allier, dépendant de l'abbaye de Saint-Denis, près de Paris, a marqué l'histoire locale.
Les moines, résidents permanents ou temporaires, usent l'église du village conjointement avec les officiants de la paroisse.
/image%2F1492036%2F20230807%2Fob_649b83_3.png)
prieuré de Manzay (18)
Les prieurés ruraux
Quand la donation initiale est conséquente et éloignée d'une église, l'abbaye récipiendaire peut faire construire un petit monastère doté d'une chapelle, de bâtiments conventuels et agricoles. Les frères et sœurs qui viennent y accomplir leurs vœux sont originaires de la région et sont reconnus comme membres de la communauté d'origine. Certains prieurés acceptent en leurs murs des sépultures étrangères à leur ordre, laïques ou religieuses.
Il convient de rappeler l'existence de plusieurs fondations établies sous ce modèle dans les campagnes du Berry. Sur la commune de Limeux, dans l'Indre, sont visibles les traces d'un important monastère, affilié à l’abbaye bénédictine de Notre-Dame d’Issoudun, pourtant géographiquement assez proche. De même peut-on citer, dans la commune de Saint-Georges-de-Poisieux, au lieu-dit Soye-l’Église, un petit édifice roman dépendant de l’abbaye de chanoines de Puyferrand, proche du Châtelet-en-Berry. Pour ce dernier exemple, nous ignorons si des religieux résidaient en permanence dans ce lieu, la règle de vie des chanoines différant de celle des ordres cloîtrés.
/image%2F1492036%2F20230807%2Fob_943d53_2.png)
prieuré de Soye (18)
© Olivier Trotignon 2023




/image%2F1492036%2F20210228%2Fob_1a13b6_dscn3629.JPG)
/image%2F1492036%2F20210228%2Fob_b45a65_capture-d-ecran-2021-02-28-a-19-18.png)
/image%2F1492036%2F20210228%2Fob_d65ebb_dscn3634.JPG)
/image%2F1492036%2F20210228%2Fob_a709b9_dscn3639.JPG)
/image%2F1492036%2F20210228%2Fob_78ce54_dscn3645.JPG)
/image%2F1492036%2F20210228%2Fob_e90ca6_barbier.png)
/image%2F1492036%2F20210228%2Fob_5f128a_cassini.png)
/image%2F1492036%2F20210228%2Fob_6f251e_em.png)